

Xiaomi prépare son offensive pour le MWC 2026 : ce qui attend le marché européen
Le rendez-vous barcelonais du Mobile World Congress 2026 s’annonce particulièrement dense pour Xiaomi. Comme souvent avec le constructeur pékinois, la stratégie de déploiement international diffère sensiblement de celle adoptée sur son marché domestique. Si l’Empire du Milieu profite traditionnellement de gammes exhaustives, l’Europe devra composer avec une sélection plus ciblée, mais non moins ambitieuse, centrée sur les Xiaomi 17 et 17 Ultra, ainsi que sur la nouvelle génération de tablettes Pad 8.
Une gamme de smartphones recalibrée pour l’international
La segmentation de Xiaomi reste fidèle à ses habitudes : tout ce qui brille en Chine ne traverse pas forcément les frontières. Pour cette cuvée 2026, les consommateurs français devront faire l’impasse sur les versions 17 Pro et 17 Pro Max, le fabricant ayant décidé de ne lancer que le modèle standard et l’Ultra sur le Vieux Continent.
Au-delà de cette sélection restreinte, quelques ajustements techniques sont à prévoir, notamment au niveau de l’autonomie. Le Xiaomi 17 Ultra destiné à nos contrées embarquerait une batterie de 6 000 mAh, contre 6 800 mAh pour son homologue chinois. Un retrait surprenant qui ne semble pourtant pas alléger l’appareil, puisque celui-ci conserverait son embonpoint avec 223 grammes sur la balance et une épaisseur de 8,29 mm.
Esthétique et finitions : les choix chromatiques se précisent
Le design reste un argument de poids pour la marque, qui déclinera son modèle Ultra en trois coloris principaux : noir, blanc et un « vert étoilé » au fini légèrement scintillant. Si les utilisateurs chinois ont droit à une variante violette, celle-ci ne semble pas au programme de la version globale pour l’instant. Parallèlement, le Xiaomi 17 Leica Edition, pièce maîtresse pour les amateurs de photographie mobile, se limitera à une sobriété classique avec des finitions noires et blanches.
La gamme Pad 8 s’invite dans les bagages de Xiaomi
La véritable surprise de ce lancement pourrait venir de la présence simultanée de la série Xiaomi Pad 8 lors de la conférence. Selon plusieurs fuites, notamment relayées par l’informateur Sudhanshu Ambhore, les tablettes ne resteraient pas cantonnées à la Chine. Les Pad 8 et Pad 8 Pro profiteraient ainsi d’une visibilité mondiale avec des fiches techniques qui n’ont rien à envier aux ordinateurs portables d’entrée de gamme.
Ces tablettes, certifiées IP54 pour la résistance aux éclaboussures, se déclineront en bleu, vert et gris. Côté performances, la version standard s’appuierait sur une puce Snapdragon 8s Gen 4, tandis que la version Pro monterait en gamme avec le Snapdragon 8 Elite. Les deux modèles partagent toutefois un écran de 11,2 pouces d’une définition 3,2K, cadencé à 144 Hz, idéal pour la consommation de contenus en Dolby Vision ou HDR10.
Des configurations solides pour tous les usages
Les récentes données issues des étiquetages énergétiques confirment les capacités de stockage attendues. La Pad 8 sera proposée en versions 128 Go ou 256 Go avec 8 Go de RAM. Pour plus de polyvalence, la Pad 8 Pro grimpera jusqu’à 512 Go de stockage et 12 Go de mémoire vive. Malgré une batterie commune de 9 200 mAh, la différence se jouera sur la vitesse de récupération : 45W pour le modèle de base contre 67W pour la version Pro.
L’ensemble de ces appareils devrait être propulsé par HyperOS 3, basé sur Android 16, avec une intégration massive de fonctionnalités liées à l’intelligence artificielle. Il ne reste plus qu’à attendre l’ouverture du MWC pour confirmer si ces caractéristiques techniques, déjà très prometteuses sur le papier, permettront à Xiaomi de s’imposer face à une concurrence toujours plus féroce sur le segment premium.
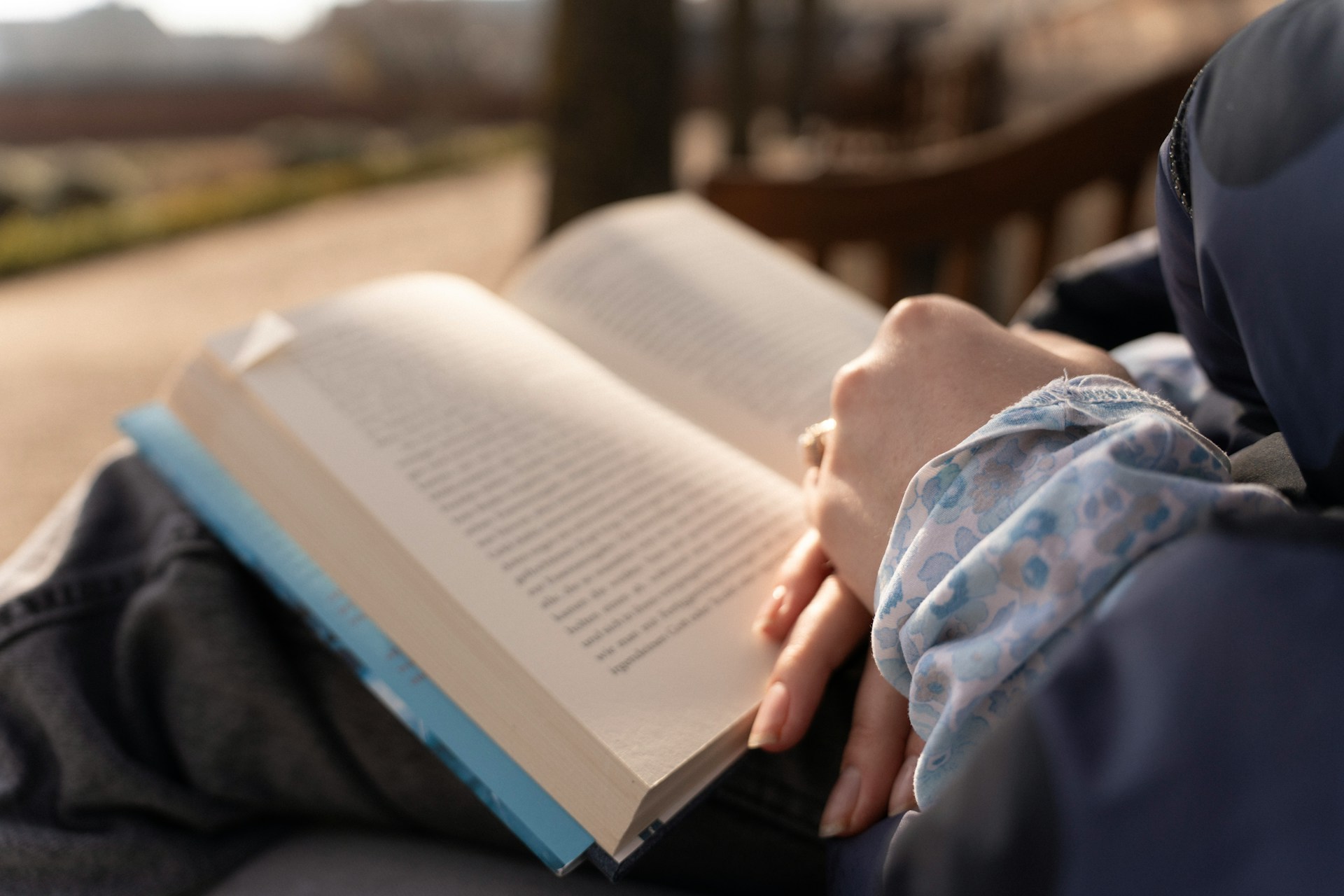
L’éducation à l’heure de l’intelligence artificielle : entre fracture sociale et révolution pédagogique
Dans une salle de classe de Cambridge, Joseph, dix ans, entraîne son modèle d’IA à distinguer des dessins de pommes de simples sourires. Lorsque la machine confond un fruit avec un visage, l’élève ne s’y trompe pas : « L’IA se trompe souvent », lance-t-il avec lucidité avant de corriger l’algorithme. En un éclair, il remet le système sur les rails, démontrant une compréhension instinctive de l’apprentissage automatique qui échappe encore à bon nombre d’adultes.
Joseph et ses camarades du club de codage de l’école primaire St Paul appartiennent à une nouvelle génération : celle des « natifs de l’IA ». Tout comme leurs aïeux n’ont jamais connu un monde sans aviation et que la génération Z a grandi avec les réseaux sociaux, ces enfants évoluent dans un univers où l’intelligence artificielle est omniprésente. Pourtant, derrière cette aisance apparente se cache une inquiétude grandissante chez les experts : le risque d’une fracture sociale majeure.
Le spectre d’une nouvelle forme d’illettrisme
Philip Colligan, directeur général de la fondation Raspberry Pi, tire la sonnette d’alarme. Selon lui, la société risque de se scinder en deux groupes distincts : d’un côté, ceux qui comprennent le fonctionnement des IA et savent les maîtriser ; de l’autre, une classe d’illettrés numériques, désarmés face à des algorithmes qui automatisent de plus en plus de décisions cruciales dans la justice, la finance ou la santé.
Pour éviter que cette technologie ne devienne un facteur d’exclusion, Colligan plaide pour que la littératie en IA soit élevée au même rang que la lecture ou l’écriture dans les programmes scolaires. Une vision partagée par Simon Peyton Jones, figure de proue de l’informatique éducative, qui redoute que les élèves ne quittent l’école sans aucune prise sur le monde qui les entoure. « Si l’IA reste une boîte noire, ses actions s’apparentent à de la magie », prévient-il. Or, ignorer les mécanismes de cette magie est, selon lui, terriblement handicapant.
Ce besoin de compréhension critique se heurte pourtant à une tendance paradoxale. Le nombre d’élèves choisissant l’informatique au GCSE (l’équivalent du Brevet au Royaume-Uni) est en baisse pour la session 2025, alors que l’histoire ou les sciences traditionnelles continuent de séduire. Certains géants de la tech, comme Anthropic, alimentent involontairement ce désintérêt en affirmant que l’IA automatisera bientôt le codage, rendant l’apprentissage technique obsolète. L’année 2025 a même vu l’émergence du « vibe coding », l’idée que le langage naturel suffira bientôt pour créer des logiciels.
Les enseignants face au mur du temps
Si l’urgence d’enseigner ces compétences est réelle, elle repose entièrement sur les épaules d’un corps enseignant déjà à bout de souffle. Les études montrent qu’un professeur travaille en moyenne 54 heures par semaine, dont moins de la moitié est consacrée à l’enseignement pur face aux élèves. Le reste du temps est englouti par une montagne de tâches administratives et de préparation de cours. C’est dans ce contexte de « pauvreté temporelle » qu’émergent des solutions technologiques visant non plus seulement à éduquer les élèves, mais à sauver les enseignants.
C’est le cas de la plateforme MagicSchool AI, dont la popularité a explosé ces dernières années. Utilisée désormais par plus de six millions d’éducateurs et d’élèves, notamment dans de grands districts scolaires comme ceux de Seattle ou d’Aurora, elle se présente comme un guichet unique pour l’IA dans l’éducation. Contrairement aux chatbots généralistes, cet outil propose plus de 80 fonctionnalités spécifiquement conçues pour le monde scolaire, allant de la planification des leçons à la différenciation pédagogique.
Un assistant pour repenser la pédagogie
La promesse de MagicSchool est pragmatique : libérer 7 à 10 heures de travail hebdomadaire pour les enseignants. L’outil permet par exemple d’adapter automatiquement le niveau de lecture d’un texte pour l’accessibilité, de générer des quiz à choix multiples ou encore de rédiger des plans de cours détaillés. L’objectif affiché est de réduire la charge mentale administrative pour permettre aux professeurs de se recentrer sur l’humain et la pédagogie.
Néanmoins, l’intégration de tels outils n’est pas sans risques. Si la plateforme offre des garde-fous de sécurité et respecte la confidentialité des données scolaires, le danger d’une dépendance excessive guette. L’automatisation, si elle est mal maîtrisée, pourrait réduire la flexibilité pédagogique ou induire une passivité chez l’enseignant. Le verdict est nuancé : MagicSchool s’avère être un levier puissant pour l’efficacité, mais il doit rester un support et non un remplaçant.
L’enjeu éducatif actuel est donc double. Il s’agit, d’une part, de former des élèves capables de comprendre la mécanique interne de l’IA pour ne pas subir ses décisions, comme le fait le jeune Joseph avec son modèle. D’autre part, il faut équiper les enseignants d’outils capables d’alléger leur quotidien sans dénaturer leur mission. La véritable alphabétisation numérique passera sans doute par cet équilibre fragile entre la maîtrise technique des élèves et l’augmentation technologique des professeurs.

Maîtriser son environnement Windows : entre gestion des mises à jour forcées et retour aux fondamentaux bureautiques
La relation entre Windows 10 et ses utilisateurs a toujours été teintée d’une certaine ambivalence. Si les mises à jour déployées par Redmond sont essentielles pour combler des failles de sécurité critiques ou corriger des bugs persistants, leur caractère parfois intrusif agace. Qui n’a jamais pesté contre un redémarrage inopiné ou, pire, l’apparition d’un écran bleu de la mort suite à une update mal digérée par le système ? Pour beaucoup, reprendre le contrôle de sa machine est devenu une priorité, tout comme le souhait de s’affranchir des modèles par abonnement pour les logiciels du quotidien. Voici comment stabiliser votre système d’exploitation et vous équiper durablement à moindre coût.
Une trêve temporaire via les paramètres classiques
Pour ceux qui souhaitent simplement repousser l’échéance sans mettre les mains dans le cambouis, Windows 10 offre une solution native, bien que limitée. Cette méthode permet de suspendre les mises à jour obligatoires jusqu’à une date précise, offrant un répit bienvenu. Pour ce faire, il faut se diriger vers les « Paramètres », puis la section « Mise à jour et sécurité » et enfin cliquer sur « Options avancées ». Un menu déroulant permet alors de sélectionner une date butoir.
Cependant, cette stratégie a ses limites. Une fois la date atteinte, le système exigera l’installation de la dernière version avant de vous autoriser à suspendre de nouveau le processus. C’est une solution de dépannage, utile mais pas définitive, d’autant que l’option de suspension est souvent proposée par défaut pour une durée déterminée.
Le blocage définitif via l’éditeur de stratégie
Pour une tranquillité d’esprit totale, il faut se tourner vers des outils plus avancés. L’éditeur de stratégie de groupe locale permet de couper le cordon de l’automatisation jusqu’à ce que vous décidiez, de votre propre chef, de lancer une installation. La manipulation requiert d’ouvrir le menu Démarrer et de taper gpedit.msc (ou de rechercher « Modifier la stratégie de groupe locale »).
Le chemin à suivre est ensuite précis : Configuration ordinateur > Modèles d’administration > Composants Windows > Windows Update. En double-cliquant sur « Configuration du service Mises à jour automatiques », une fenêtre s’ouvre où il suffit de cocher « Désactivé ». Dès l’application de ce paramètre, votre machine cessera toute initiative autonome.
Il est important de noter que cela ne vous coupe pas des correctifs de sécurité : la recherche manuelle reste fonctionnelle. Un tour dans les paramètres pour cliquer sur « Rechercher des mises à jour » suffira à installer les derniers patchs, mais uniquement lorsque vous l’aurez décidé. Si l’envie vous prend de revenir au comportement par défaut, il suffira de repasser l’option sur « Non configuré ».
Une gestion plus fine des notifications
Si le blocage total vous semble trop radical, cette même interface gpedit .msc permet une approche plus nuancée. En sélectionnant « Activé » dans la configuration du service, vous accédez à des options de personnalisation. Le choix le plus pertinent est souvent « Notifier les téléchargements et installations automatiques ».
Cette configuration transforme Windows en un système qui propose au lieu d’imposer. Vous êtes alerté de la disponibilité d’une mise à jour, mais le téléchargement ne démarre qu’avec votre aval. D’autres options permettent également de planifier les installations à des horaires précis, évitant ainsi que votre PC ne redémarre en plein travail.
S’équiper sans s’abonner : l’alternative Office 2021
Cette volonté de reprendre la main sur son outil informatique ne s’arrête pas au système d’exploitation. Elle concerne aussi les logiciels. À l’heure où le « tout abonnement » devient la norme, beaucoup regrettent l’époque où l’on achetait une licence une bonne fois pour toutes. C’est exactement ce que propose actuellement une offre sur Microsoft Office Professionnel 2021 pour Windows.
Loin des promesses marketing sur le « futur de la productivité », cette suite répond à un besoin pragmatique : ouvrir et éditer les fichiers que tout le monde utilise, sans avoir à louer son logiciel mois après mois. Proposée aux alentours de 35 dollars (au lieu du tarif habituel dépassant les 200 dollars), cette licence perpétuelle comprend les piliers de la bureautique : Word pour le traitement de texte, Excel pour les données, PowerPoint pour les présentations et Outlook pour la gestion des mails. La suite inclut également OneNote, Publisher, Access ainsi que la version gratuite de Teams.
Ce qu’il faut savoir avant d’investir
Il est crucial de comprendre ce que cette offre implique pour éviter toute déconvenue. Il ne s’agit pas de Microsoft 365 : vous n’aurez pas de stockage cloud évolutif ni de fonctionnalités connectées avancées. La licence est liée à un seul appareil et non à votre compte Microsoft, ce qui signifie qu’elle est « ancrée » à la machine sur laquelle vous l’installez.
De plus, des contraintes techniques existent. Cette version est conçue exclusivement pour Windows 10 ou 11 (incompatible avec Windows 7 ou 8) et nécessite un écran avec une résolution minimale de 1280×800. Attention également aux utilisateurs de machines virtuelles comme Parallels Pro : cette licence n’est pas compatible avec la virtualisation. Enfin, une fois l’achat effectué, vous disposez d’un délai de 7 jours pour activer la clé. C’est une solution idéale pour ceux qui considèrent leur PC Windows comme un outil de production stable et qui souhaitent s’équiper durablement sans la pression récurrente des abonnements.

Intel : entre partenariat stratégique avec AMD et révolution technologique avec Panther Lake
Le secteur des semi-conducteurs est en pleine effervescence, avec Intel au centre de deux annonces majeures qui pourraient redéfinir le paysage technologique. D’un côté, des rumeurs persistantes font état d’une collaboration historique avec son rival AMD ; de l’autre, l’entreprise s’apprête à lancer sa nouvelle architecture de processeurs, Panther Lake, promettant des avancées significatives pour les ordinateurs portables.
Vers une collaboration inattendue entre Intel et AMD ?
Selon plusieurs sources de l’industrie, des négociations seraient en cours entre les deux géants américains des puces, Intel et AMD, en vue d’une coopération au niveau de la production. Une telle alliance, si elle se concrétisait, pourrait non seulement renforcer de manière significative les activités de fonderie d’Intel (Intel Foundry Services), mais également marquer un tournant pragmatique dans le paysage concurrentiel. Ce partenariat potentiel est perçu comme une démarche stratégique capable d’entraîner des changements structurels profonds dans l’industrie mondiale des semi-conducteurs.
Panther Lake : l’architecture hybride à son apogée
Parallèlement à ces manœuvres stratégiques, Intel s’apprête à dévoiler, le 9 octobre prochain, sa nouvelle architecture de processeurs : Panther Lake. Présentée comme l’itération « la plus aboutie » de sa technologie hybride, elle promet d’offrir une combinaison optimisée de cœurs performants (P-Cores) et de cœurs efficients (E-Cores). S’appuyant sur les fondations de l’architecture précédente, Lunar Lake, Panther Lake est annoncé avec des améliorations majeures, notamment l’intégration des nouveaux cœurs graphiques Xe3, et se destine à équiper la prochaine génération d’ordinateurs portables.
Une stratégie affinée pour l’écosystème PC
Bien que les détails complets ne soient pas encore connus, des ingénieurs d’Intel ont évoqué des améliorations de fond, telles qu’un îlot d’alimentation dédié aux cœurs basse consommation pour les tâches de fond, ainsi que des optimisations du Thread Director et de l’ordonnancement au niveau du système d’exploitation.
Jim Johnson, vice-président du Client Computing Group chez Intel, a expliqué cette évolution : « Avec Lunar Lake, nous avons validé l’architecture dans un format très intégré, proche de celui d’un smartphone. Avec Panther Lake, nous adoptons une approche bien plus favorable à l’écosystème PC, permettant aux fabricants (OEM) d’adopter ces produits de la manière dont ils aiment concevoir leurs ordinateurs. » L’objectif est désormais de renforcer la puissance de calcul hybride tout en facilitant l’intégration par des partenaires clés comme Microsoft ou Lenovo, qui se montreraient déjà « enthousiastes ».
Autonomie et confiance : les promesses de la maturité
Cette nouvelle gestion des cœurs P et E se traduira par des gains massifs en matière d’autonomie. La clé réside dans une répartition plus intelligente des charges de travail, où le type de cœur adéquat est sollicité pour chaque tâche spécifique, optimisant ainsi la consommation d’énergie. Cette maîtrise est le fruit d’un long parcours d’affinements, depuis les premières ébauches avec Lakefield, en passant par Alder Lake, Meteor Lake et plus récemment Lunar Lake. Aujourd’hui, avec Panther Lake, Intel semble atteindre un niveau de maturité qui lui confère une confiance renouvelée dans sa stratégie hybride.

Bitcoin pulvérise les records, propulsé par les ETF et un contexte économique incertain
Le marché des cryptomonnaies connaît une effervescence sans précédent. Dimanche, le Bitcoin a franchi un nouveau sommet historique en dépassant les 125 000 dollars, effaçant son précédent record de près de 124 000 dollars établi en août. Cette spectaculaire ascension, qui s’inscrit dans la tendance saisonnière favorable d’« Uptober », est principalement alimentée par l’engouement massif pour les fonds négociés en bourse (ETF) Bitcoin au comptant et par une quête de valeurs refuges de la part des investisseurs.
Des afflux records vers les ETF Bitcoin
La semaine dernière, les ETF Bitcoin américains ont enregistré leur deuxième plus importante semaine d’afflux nets depuis leur lancement en janvier 2024, avec un total de 3,24 milliards de dollars injectés. Ce rebond spectaculaire, qui fait suite à une semaine de sorties de 902 millions de dollars, témoigne d’un regain de confiance des investisseurs. Le record hebdomadaire absolu reste celui de la semaine du 22 novembre 2024, avec 3,38 milliards de dollars.
Le fonds iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock domine largement le marché, captant à lui seul 1,8 milliard de dollars de ces nouveaux flux. Avec des actifs sous gestion s’élevant désormais à 96,2 milliards de dollars, IBIT est devenu le véhicule privilégié des investisseurs institutionnels. En comparaison, le fonds de Fidelity (FBTC), deuxième acteur du marché, a attiré 692 millions de dollars. La journée de vendredi a été particulièrement intense, avec 985 millions de dollars d’entrées nettes sur l’ensemble des ETF, frôlant le record journalier.
Un contexte macroéconomique favorable
Cette dynamique est renforcée par plusieurs facteurs externes. Selon les analystes, le blocage gouvernemental aux États-Unis pousse les investisseurs à se tourner vers des actifs perçus comme des valeurs refuges, tels que l’or, qui a également atteint de nouveaux sommets, et le Bitcoin.
De plus, l’offre de Bitcoins disponibles sur les plateformes d’échange centralisées a atteint son plus bas niveau depuis six ans, avec seulement 2,83 millions de jetons. Cette raréfaction de l’offre accentue la pression à l’achat et amplifie l’impact des afflux via les ETF. Les observateurs du marché estiment que le niveau de 117 300 dollars constitue un support solide, avec un potentiel haussier vers 140 000 dollars si la dynamique actuelle se maintient.
Un contraste saisissant avec la crise de confiance passée
Cette euphorie actuelle tranche radicalement avec le climat morose qui régnait sur le marché il y a quelques mois. On se souvient de la chute libre provoquée par la faillite de la plateforme FTX, un événement qui avait gravement ébranlé la confiance des investisseurs. À cette époque, entre le 14 et le 21 novembre, la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies s’était effondrée de 5 % pour atteindre 795 milliards de dollars, son plus bas niveau depuis décembre 2020.
Le Bitcoin s’échangeait alors sous les 16 000 dollars, bien loin de son pic de près de 69 000 dollars atteint en novembre 2021. De son côté, l’Ethereum était passé sous le seuil critique des 1 200 dollars, pénalisé notamment par des rumeurs selon lesquelles une partie des fonds détournés de FTX (estimés à 663 millions de dollars) était constituée d’Ether. Le marché tout entier subissait les conséquences de cette crise, entraînant la grande majorité des altcoins dans le rouge.
La rapidité de ce retournement de situation illustre la volatilité du secteur, mais surtout la confirmation que l’adoption institutionnelle, portée par des géants comme BlackRock, est bel et bien en marche et redéfinit en profondeur la structure du marché.

BC Card dépose un brevet stratégique pour le paiement par stablecoin
La société BC Card, unique entreprise spécialisée dans le traitement des paiements en Corée du Sud, a annoncé ce 18 septembre avoir déposé une demande de brevet pour une technologie clé, une première dans le secteur, destinée au traitement des paiements en stablecoins. Par cette initiative, l’entreprise entend sécuriser des droits de propriété intellectuelle stratégiques et s’adapter rapidement au nouveau paradigme des paiements axés sur les actifs numériques.
Une technologie pour une facturation transparente et équitable
Le brevet porte sur un procédé permettant de déterminer avec précision le nombre de jetons à déduire du portefeuille numérique d’un client lors d’une transaction. Cette innovation répond à une problématique concrète : les légères différences de cours d’un même stablecoin entre les diverses plateformes d’échange, dues aux volumes de transactions. La technologie développée par BC Card collecte et analyse les données de marché en temps réel pour garantir un montant de règlement à la fois juste et transparent au moment de l’autorisation de la transaction et du débit du solde.
Un potentiel significatif pour les transactions internationales
Cette avancée technologique est jugée particulièrement pertinente pour les paiements transfrontaliers, un domaine où les stablecoins présentent une forte valeur ajoutée. Elle devrait s’avérer très efficace dans des situations telles que le paiement chez un commerçant à l’étranger avec un stablecoin adossé au won sud-coréen, ou inversement, le règlement chez un commerçant local avec un stablecoin basé sur une devise étrangère.
L’implication personnelle du PDG dans l’innovation
Choi Won-seok, le président-directeur général de BC Card, a personnellement participé au développement de cette technologie. Son implication témoigne de l’engagement de l’entreprise dans la modernisation des infrastructures de paiement basées sur la blockchain. Entre 2022 et 2024, M. Choi avait déjà déposé en son nom six brevets relatifs à des technologies de paiement liées aux NFT. « Cette technologie a été conçue avant tout pour la commodité du client, en s’éloignant d’une perspective purement technique pour permettre aux consommateurs d’utiliser les stablecoins plus facilement », a-t-il expliqué.
Vers une infrastructure de paiement universelle en Corée
En phase avec l’évolution du cadre réglementaire national, BC Card se concentre sur la construction d’une infrastructure de paiement universelle visant à dynamiser le marché coréen des stablecoins. Pour ce faire, l’entreprise noue des partenariats avec de grandes institutions financières, des entreprises de la fintech et des fournisseurs de services d’actifs virtuels. L’objectif est de connecter son vaste réseau de commerçants affiliés aux services de stablecoins de ses partenaires, afin de permettre aux clients de régler leurs achats de manière simple et familière, que ce soit par carte ou via un QR code.
La vision d’un leader du paiement
« Les stablecoins sont un paradigme technologique puissant qui va révolutionner les processus de paiement existants », a affirmé Choi Won-seok. « En tant qu’entreprise disposant de la plus grande infrastructure de paiement du pays, BC Card sera à l’avant-garde pour créer un environnement où les services de paiement par stablecoin pourront être utilisés partout et en toute simplicité. »

Fin de saison en WNBA : les Wings surprennent, les Lynx se préparent pour les playoffs
La saison régulière 2025 de la WNBA s’est achevée ce jeudi avec des fortunes diverses pour les équipes. Tandis que les Dallas Wings ont conclu une année difficile par une victoire de prestige, les Minnesota Lynx ont validé leur statut de prétendante au titre en choisissant leur adversaire pour le premier tour des playoffs.
Une victoire pour l’honneur à Dallas
À Arlington, au Texas, les Dallas Wings (10-34) ont terminé leur saison décevante sur une note positive en s’imposant largement 97-76 face au Phoenix Mercury (27-17), une équipe pourtant qualifiée pour les playoffs. Cette victoire permet aux Wings de sauver l’honneur après une saison marquée par une série de 11 défaites en 12 matchs pour commencer, et de 10 défaites sur les 11 dernières rencontres.
Portées par une Paige Bueckers en état de grâce, les Wings ont pris le contrôle du match dès la fin du premier quart-temps. La jeune star a mené son équipe avec 24 points, 8 rebonds et 7 passes décisives. Bien secondée par Aziaha James, sortie du banc pour inscrire 18 points et capter 8 rebonds, l’équipe a surclassé Phoenix 57-32 dans les deuxième et troisième quart-temps. Côté Mercury, l’ancienne joueuse des Wings, Satou Sabally, a été la meilleure marqueuse avec 14 points. Malgré cette victoire, Dallas conserve les meilleures chances d’obtenir le premier choix de la draft pour la deuxième année consécutive.
Après le match, Bueckers s’est adressée à la foule avec un message d’espoir : « Les résultats vont arriver, je vous le promets. Continuez de nous soutenir. »
Paige Bueckers, une rookie déjà historique
La performance de Paige Bueckers vient couronner une saison de rookie exceptionnelle qui devrait, sauf énorme surprise, lui valoir le titre de « Rookie de l’Année ». Avec les 24 points inscrits jeudi, elle a porté son total à 692 points, devenant ainsi la troisième meilleure marqueuse de l’histoire de la WNBA pour une première saison, dépassant A’ja Wilson.
Cinquième meilleure marqueuse de la ligue (19,1 points par match) et neuvième meilleure passeuse (5,3 passes), elle a survolé la concurrence. Ses principales rivales, Sonia Citron et Kiki Iriafen des Washington Mystics, bien que talentueuses, se sont probablement neutralisées dans la course à ce trophée. Bueckers a également marqué les esprits avec des performances mémorables, dont un match à 44 points contre les Los Angeles Sparks le 20 août, établissant un nouveau record pour une rookie.
L’avenir incertain du coaching
Malgré deux saisons consécutives avec un bilan très faible, l’entraîneur Chris Koclanes devrait conserver son poste. Arrivé en même temps que le nouveau manager général Curt Miller et la superstar en devenir Paige Bueckers, 2025 est considérée comme la première véritable année d’un nouveau cycle de reconstruction. Miller a personnellement choisi Koclanes, et il semble peu probable qu’il s’en sépare après une seule saison, malgré les longues séries de défaites et des choix tactiques parfois discutés. La patience semble être le maître-mot à Dallas.
Les Lynx choisissent leur destin en playoffs
Pendant ce temps, à Minneapolis, les Minnesota Lynx ont dominé les Golden State Valkyries 72-53 dans un match dont l’enjeu était crucial. Une victoire assurait aux Lynx d’affronter cette même équipe de Golden State, une franchise d’expansion qu’ils ont battue quatre fois en quatre confrontations cette saison. Une défaite les aurait opposés à Seattle, une équipe qui les a vaincus à deux reprises.
Les Lynx ont donc choisi leur adversaire et aborderont le premier tour des playoffs avec un avantage psychologique certain.
Napheesa Collier dans l’histoire, en route vers le titre de MVP ?
La star des Lynx, Napheesa Collier, a profité de ce dernier match pour entrer dans un cercle très fermé. En réussissant 3 de ses 4 tirs à trois points, elle est devenue la deuxième joueuse de l’histoire de la WNBA, après Elena Delle Donne en 2019, à atteindre le fameux seuil du « 90-50-40 » : 90 % de réussite aux lancers francs, 50 % aux tirs et 40 % à trois points sur une saison.
Sa coach, Cheryl Reeve, n’a pas manqué de souligner cet exploit pour plaider sa cause dans la course au titre de MVP (Most Valuable Player) : « C’était un objectif ambitieux que nous avions fixé avec elle. Les chiffres ne mentent pas. Les votants devraient en tenir compte… Napheesa Collier a été la meilleure joueuse de la WNBA cette saison et mérite d’être MVP. »

Xiaomi : une menace grandissante pour Tesla sur le marché de la voiture électrique
Le géant de la tech Xiaomi, connu pour ses smartphones, a fait une entrée spectaculaire sur le marché automobile il y a à peine un an. Son premier véhicule, la berline SU7, est déjà un succès commercial retentissant, défiant les pronostics et prouvant que le passage de l’électronique à l’automobile peut être une réussite fulgurante.
Une technologie de batterie promettant de pulvériser les records
Alors que le succès de la SU7 se confirme, Xiaomi prépare déjà la suite et ne cache pas ses ambitions de dominer le secteur grâce à une innovation technologique majeure. Les informations qui nous parviennent du site chinois 36kr indiquent que la future « Xiaomi Car » pourrait être proposée en deux versions, se distinguant principalement par leur batterie.
La première serait équipée d’une batterie LFP (Lithium Fer Phosphate) « Blade » du constructeur BYD, une technologie reconnue pour sa fiabilité et sa sécurité. Cependant, c’est la seconde version qui suscite le plus d’intérêt. Elle embarquerait une batterie Qilin, conçue par le géant CATL. Cette dernière repose sur une technologie NMC innovante qui intègre les cellules directement dans le châssis du véhicule. Cette approche permet une densité énergétique exceptionnelle, promettant une autonomie d’environ 1000 kilomètres en une seule charge. De plus, elle offrirait une recharge ultra-rapide, passant de 10 % à 80 % en seulement 10 minutes.
À titre de comparaison, la Tesla Model S Grande Autonomie affiche 652 km, tandis que la Model 3 Performance atteint 530 km. Bien que Xiaomi ne soit pas le premier à atteindre ce cap symbolique des 1000 km – la Nio ET5 l’a déjà fait –, cette proposition technologique positionne clairement la marque comme un concurrent très sérieux.
Des chiffres de vente qui confirment l’ambition
Le succès de Xiaomi n’est pas qu’une promesse technologique ; il se traduit déjà dans les chiffres. En août, la startup a fait son entrée pour la première fois dans le top 10 du marché chinois des véhicules à énergie nouvelle (NEV), une catégorie qui inclut les véhicules 100 % électriques et les hybrides rechargeables. Avec un total de 36 396 unités livrées sur le mois, Xiaomi démontre une capacité de production impressionnante.
La berline SU7, malgré une légère baisse par rapport à juillet, s’est écoulée à près de 20 000 exemplaires en août. Ce tassement s’explique par le lancement du nouveau crossover YU7, qui a immédiatement trouvé son public avec 16 548 livraisons, après un démarrage à un peu plus de 6 000 unités en juillet.
Le géant américain Tesla dans le viseur
Cette montée en puissance place Xiaomi en confrontation directe avec le leader du marché, Tesla. Le même mois, la firme américaine a vendu 57 152 voitures en Chine. Si l’écart reste significatif, la trajectoire de Xiaomi est fulgurante. Pendant que les ventes de Tesla connaissent un ralentissement à l’échelle mondiale, y compris en Chine, Xiaomi gagne rapidement des parts de marché. Le nouveau crossover YU7, en particulier, s’annonce comme un concurrent redoutable pour le best-seller de Tesla, le Model Y.
Les clés d’une réussite qui déjoue les pronostics
La réussite de Xiaomi est d’autant plus remarquable qu’elle contredit le célèbre mantra d’Elon Musk : « les prototypes sont faciles, la production est difficile ». Là où de nombreuses startups, y compris des géants comme Apple ou Dyson, ont échoué et où des entreprises comme Rivian ont brûlé des milliards sans atteindre une rentabilité claire, Xiaomi a réussi du premier coup.
Plusieurs facteurs expliquent ce succès. L’expérience de Xiaomi dans la production de masse de produits électroniques complexes est un atout, mais la véritable différence réside probablement dans son ancrage dans l’écosystème industriel chinois. La marque a non seulement vendu un nombre record de son premier modèle, mais vise déjà à atteindre un flux de trésorerie positif d’ici la fin de l’année, une performance que peu d’acteurs de l’industrie automobile peuvent revendiquer aussi tôt dans leur histoire.

Les résultats de Nvidia, un test crucial pour Wall Street après l’euphorie de la Fed
Wall Street aborde la semaine à des niveaux records, portée par un fort optimisme suite aux déclarations du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, qui ont ouvert la voie à une potentielle baisse des taux en septembre. Cependant, cette dynamique sera mise à l’épreuve par la publication très attendue des résultats de Nvidia (NVDA), le géant des semi-conducteurs et leader de l’intelligence artificielle.
Le discours accommodant de Jerome Powell
La semaine dernière s’est terminée en fanfare pour les marchés boursiers. Le catalyseur de cette envolée fut le discours de Jerome Powell lors du symposium de Jackson Hole. Ses propos ont été interprétés par les investisseurs comme un signal clair en faveur d’une baisse des taux d’intérêt dès le mois prochain. Le président de la Fed a notamment souligné que « l’équilibre changeant des risques pourrait justifier un ajustement de notre politique monétaire ». Il a également mis en avant que « les risques de dégradation sur le front de l’emploi augmentent », tout en estimant que l’impact des tarifs douaniers sur l’inflation serait probablement « relativement de courte durée ». Ces mots ont suffi à déclencher une vague d’achats.
Bilan hebdomadaire : des indices au sommet
Cette vague d’optimisme a propulsé le Dow Jones Industrial Average (^DJI) à un nouveau record historique, enregistrant une hausse de 1,5 % sur la semaine. Le S&P 500 (^GSPC) a progressé de 0,3 %, atteignant également des sommets. De son côté, le Nasdaq Composite (^IXIC), après avoir chuté en milieu de semaine, a réussi à limiter ses pertes hebdomadaires à 0,5 %, porté par le rebond de vendredi. Les valeurs de croissance, qui avaient souffert, ont également fortement réduit leurs pertes ou sont repassées dans le vert à la clôture.
Les projecteurs braqués sur Nvidia et l’agenda économique
L’événement majeur de la semaine sera sans conteste la publication des résultats trimestriels de Nvidia, prévue mercredi après la clôture des marchés. Les performances et, surtout, les prévisions du géant des puces auront un impact considérable sur la direction du marché, en particulier pour les valeurs technologiques liées à l’intelligence artificielle et aux semi-conducteurs. Au-delà de Nvidia, le calendrier économique sera également chargé, avec des mises à jour attendues sur l’inflation, la croissance du PIB, les ventes de logements et le moral des consommateurs. D’autres entreprises comme Dell (DELL), Best Buy (BBY) ou encore Dollar General (DG) publieront aussi leurs résultats.
Tendance initiale : prudence en début de semaine
Malgré l’euphorie de vendredi, les contrats à terme sur les principaux indices américains affichent une légère baisse lundi matin, suggérant une ouverture prudente. Les futures sur le Dow Jones reculent de 0,2 %, ceux sur le S&P 500 de 0,25 % et ceux sur le Nasdaq 100 de 0,3 %. Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans est en légère hausse à 4,28 %. Les cryptomonnaies connaissent quant à elles une baisse plus marquée. Il convient de rappeler que l’activité sur les marchés à terme avant l’ouverture ne préjuge pas nécessairement de la tendance de la séance boursière.

La Maison-Blanche envisage de substituer le Bitcoin à l’or dans ses réserves stratégiques
Le gouvernement américain pourrait être à l’aube d’un changement de paradigme majeur concernant sa politique sur les actifs numériques. Une nouvelle orientation stratégique, proposée par la Maison-Blanche, suggère de considérer le Bitcoin comme un actif de réserve équivalent à l’or. Cette annonce intervient dans un contexte de forte volatilité pour les cryptomonnaies, dont les cours ont récemment chuté suite à la publication d’indicateurs d’inflation américains plus élevés que prévu.
Une nouvelle doctrine pour les actifs numériques
Un groupe de travail de la Maison-Blanche sur les actifs numériques a récemment publié un rapport de 160 pages intitulé « Renforcer le leadership américain dans la technologie financière numérique ». Élaboré avec la participation des principaux départements et agences fédérales, dont le Trésor, le département du Commerce, la Securities and Exchange Commission (SEC), la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), l’Office of the Comptroller of the Currency (OCC) et la Réserve Fédérale (Fed), ce document propose une refonte complète de l’approche américaine.
La recommandation la plus audacieuse est de développer une stratégie permettant aux États-Unis d’acquérir davantage de Bitcoins pour les intégrer à leurs réserves stratégiques. Le rapport insiste sur le fait que cette politique doit être mise en œuvre sans recourir à de nouvelles enveloppes budgétaires ni à une augmentation des impôts, afin de ne pas peser sur les contribuables américains. Bien que les méthodes de financement ne soient pas explicitement détaillées, les experts du secteur estiment que le gouvernement pourrait réallouer une partie de ses actifs existants, notamment en vendant une portion de ses réserves d’or pour acheter des Bitcoins. Le gouvernement américain, qui détient actuellement environ 200 000 Bitcoins, a réaffirmé son intention de ne pas les vendre et de les conserver comme un actif de réserve à long terme, au service des objectifs politiques nationaux.
Cadre réglementaire : entre interdiction et innovation
Le rapport officialise également une position ferme contre la création d’une monnaie numérique de banque centrale (MNBC). Conformément à un décret présidentiel et à une loi adoptée par la Chambre des représentants, la Réserve Fédérale ne pourra pas émettre ou gérer unilatéralement une monnaie numérique ; une telle initiative nécessiterait au préalable une législation spécifique votée par le Congrès.
Parallèlement, l’administration clarifie le statut des stablecoins adossés au dollar. La loi « GENIUS », récemment signée par le Président, instaure un cadre réglementaire précis pour ces actifs, avec des exigences claires en matière de licences, de réserves, de transparence et de protection des consommateurs. Les stablecoins sont désormais classés comme une catégorie d’actifs distincte, et non comme des valeurs mobilières ou des matières premières.
Le document préconise également une approche plus ouverte de la part des régulateurs bancaires. Il leur est demandé de ne pas restreindre l’accès aux services pour l’industrie des cryptomonnaies, mais plutôt d’appliquer des exigences de fonds propres qui reflètent fidèlement les risques associés. L’objectif est d’apporter plus de clarté et de transparence aux processus d’obtention de licences bancaires et d’accès aux comptes maîtres de la Fed, tout en soutenant l’innovation, notamment via des réglementations sur mesure pour les logiciels de portefeuilles entièrement décentralisés.
Lutte contre la criminalité et clarifications fiscales
La stratégie de lutte contre les activités illicites est également redéfinie. Plutôt que des mesures de répression générales qui pourraient freiner l’activité légitime, l’accent sera mis sur des « enquêtes ciblées », favorisées par un meilleur partage d’informations entre les secteurs public et privé.
Sur le plan fiscal, l’administration s’engage à clarifier plusieurs zones d’ombre, notamment le traitement des plus-values latentes sur les actifs numériques dans le calcul de l’impôt minimum des sociétés, la fiscalité des revenus issus du staking et du minage, ou encore les transactions de wrapping et unwrapping. L’application des règles sur les ventes fictives (wash sales) et la possibilité d’accorder des avantages fiscaux sont également à l’étude.
Selon Kang Bong-ju, expert au Centre Financier International, « ce rapport signale une orientation clairement pro-entreprise, visant à intégrer les actifs numériques dans le cadre légal tout en assouplissant la réglementation sur leur émission et leur circulation ». Il note cependant que « l’allègement des obligations de lutte contre le blanchiment d’argent pourrait compliquer l’identification des acteurs malveillants ». La pérennité de cette politique après un éventuel changement d’administration reste la principale incertitude.
Le marché réagit à l’inflation américaine
Cette potentielle réorientation stratégique intervient alors que le marché des cryptomonnaies fait face à une forte turbulence. Le 15 août, vers 10h00, le Bitcoin s’échangeait autour de 118 000 $, en baisse de plus de 4 % sur 24 heures. La veille, il avait pourtant battu son record historique en dépassant les 124 200 $. L’Ethereum a suivi une tendance similaire, chutant d’environ 3 % pour s’établir à 4 580 $, après avoir frôlé les 4 770 $.
Cette correction brutale s’explique par la publication, le 14 août, de l’indice des prix à la production (IPP) américain pour le mois de juillet. Celui-ci a augmenté de 0,9 % par rapport au mois précédent, déjouant largement les prévisions des analystes qui tablaient sur une hausse de 0,2 %. Considéré comme un indicateur avancé de l’inflation des prix à la consommation, cet indice a ravivé les craintes inflationnistes.
Avant cette publication, des données macroéconomiques plus faibles avaient renforcé l’espoir que la Réserve Fédérale abaisse ses taux d’intérêt dès le mois de septembre. Ces anticipations avaient provoqué un afflux de capitaux vers les actifs à risque comme les cryptomonnaies, entraînant leur envolée. Cependant, les chiffres de l’IPP ont douché cet optimisme. Selon l’outil FedWatch du CME Group, la probabilité d’une baisse des taux en septembre a reculé, tandis que la possibilité d’un maintien des taux au niveau actuel a refait surface, passant de 0 % à 7,9 %. Ce changement de perspective a suffi à inverser la tendance sur le marché des cryptomonnaies.










